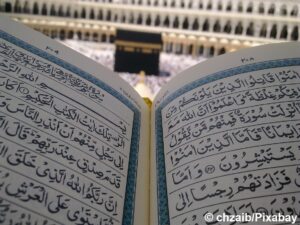Des Frères Musulmans au Hamas, des mosquées aux réseaux associatifs, l’islam politique tisse sa toile en Europe. Entre influence idéologique, double discours et liens ambigus avec le djihadisme, l’Occident fait face à un défi majeur pour ses valeurs démocratiques et sa sécurité.
Léa Sauchay
L’Europe occidentale fait face depuis maintenant plusieurs décennies à une montée de la radicalisation au sein d’une fraction de ses populations musulmanes. Ce phénomène ne se limite pas à des actes spectaculaires de violence ou à des recrutements pour des groupes terroristes tel que Daech ou Al-Qaïda. Il englobe également l’émergence de réseaux prônant une vision rigoriste de l’islam, l’érosion des principes de laïcité, et la montée d’un discours identitaire en rupture avec les valeurs des sociétés européennes.
Frères Musulmans : historique et idéologie
Les Frères Musulmans constituent un exemple emblématique d’organisation transnationale capable d’exercer une influence majeure sur les institutions religieuses, politiques, culturelles et sociales.
Fondée en 1928 en Égypte par Hassan al-Banna, la confrérie des Frères Musulmans se présente comme un mouvement social, religieux et politique visant à rétablir un État islamique basé sur la charia. Bien qu’attestant être un mouvement non violent, les Frères musulmans ont à plusieurs reprises été accusés de soutenir, financer et inspirer des activités terroristes que ce soit par leurs membres affiliés ou par des branches du groupe. Ces zones grises alimentent une méfiance croissante à son encontre, notamment dans les pays occidentaux et dans le monde arabe.
Fondé en 1987, le Hamas est communément considéré comme une émanation palestinienne des Frères musulmans. Mêlant islam sunnite radical et nationalisme palestinien, le mouvement se structure en deux branches distinctes : une aile politique, active au sein des institutions locales, et une branche armée, responsable d’actions violentes à l’encontre d’Israël.
Le Hamas est classé organisation terroriste par l’Union européenne, les États-Unis, le Canada, ou encore l’Égypte, en raison de son recours régulier à des attentats-suicides, des tirs de roquettes, et des prises d’otages. L’attaque du 7 octobre 2023 contre le territoire israélien, d’une ampleur sans précédent, a marqué une escalade brutale dans le conflit israélo-palestinien. Le Hamas justifie son action par une vision religieuse de la Palestine historique (dont Israël), serait une terre musulmane qui ne peut être gouvernée que par des musulmans. En effet ces terres ont été pendant près de 1300 ans a majorité arabe et musulmane alors que pour les juifs israéliens, cette terre leur revient de droit puisque c’est celle de leurs ancêtres qui s’y étaient établis il y a plus de 3000 ans et qu’une partie de la communauté juive ne les a jamais quittés. En représailles, Israël n’a cessé de bombarder la bande de Gaza causant plusieurs dizaines de milliers de morts. Pour faire pression, le Hamas se sert toujours des otages capturés lors de l’attentat du 7 octobre et utilise la population palestinienne comme bouclier humain afin d’indigner et de faire réagir la communauté internationale. Récemment, Eli Sharabi, un otage capturé lors de l’attentat du 7 octobre a été remis en liberté après 491 jours de captivité. Sur les images du Hamas, on le voit amaigri, récitant le message suivant : « Je me sens très très heureux aujourd’hui de retrouver ma famille (…) Ma femme et mes filles ». Pourtant il ne les reverra jamais puisque le groupe armé les a déjà exécutées au moment de la mise en scène.
Lien entre islam politique et terrorisme
Ayman al-Zawahiri, ancien leader l’Al Qu’Aïda est né dans une famille proche des Frères Musulmans, au Caire. Il intégrera en 1966 « l’Organisation du Jihad » à seulement 15 ans. Ce groupe s’est inspiré des idées radicales de Sayyid Qutb, un idéologue islamiste et membre influent des Frères Musulmans qui a notamment théorisé la notion de « Jahiliyya », c’est-à-dire le rejet total des sociétés modernes considéré comme aussi impies que les sociétés préislamiques. Pour Qutb, les musulmans ne devraient pas uniquement islamiser progressivement la société, mais détruire ces États pour instaurer un régime islamique. Les dirigeants musulmans qui ne gouvernent pas selon la charia sont pour lui des apostats ce qui permet de légitimer les assassinats politiques et attaques terroristes à leur encontre.
En effet, le sujet de l’apostasie fait débat au sein de la communauté musulmane. D’une part, il n’est pas mentionné dans le Coran qu’un apostat doit mourir, mais uniquement « qu’Allah ne leur pardonnera pas » (Sourate 4 verset 137). Dans les Hadiths, la deuxième source principale de l’Islam qui correspond au récit rapportant les paroles du prophète Mohammed, il est explicitement dit que les apostats doivent être tués. Les savants, terme utilisé en Islam pour désigner un religieux, reconnu pour avoir étudié plusieurs disciplines religieuses et son intégrité, se divisent en deux catégories.
La première, les savants classiques estiment, par exemple, que le hadith Sahih al-Boukhari (6922) ‘Celui qui change de religion, tuez-le’ doit être pris au sens littéral, tandis que les savants modernes le replacent dans son contexte historique en ajoutant que cette peine s’applique uniquement s’il y a trahison politique. Les quatre grandes écoles sunnites préconisent toutes la peine de mort, avec une légère variante en fonction du sexe ou de la durée.
Pour les hanafites (45 pour cent), l’apostat a 3 jours pour se repentir avant d’être condamné à mort. Pour les malikites (25 pour cent), l’apostat, si c’est un homme, doit être exécuté immédiatement. Si l’apostat est une femme, elle doit être emprisonnée. Pour les chaféites (20 pour cent), l’exécution doit être immédiate après la sommation. Pour les hanbalites (10 pour cent), l’exécution doit être immédiate.
A la fin des années 1970, les Frères Musulmans adoptent une stratégie plus pragmatique : participation au jeu politique, dialogue avec les États, inscription dans le champ associatif et éducatif. Cette orientation est perçue comme une trahison idéologique par une nouvelle génération de militants islamistes, influencée par les écrits de Sayyid Qutb. Parmi eux, Ayman al-Zawahiri se distingue. Médecin égyptien issu d’un milieu bourgeois lié à la confrérie, il adhère dès l’adolescence à une cellule clandestine prônant le jihad armé.
En 1981, les membres du Jihad islamique égyptien assassinent le président, ce qui marque une rupture totale avec les Frères Musulmans qui n’approuvent pas cette violence.
En 2012, les Frères Musulmans accèdent au pouvoir. Dans son livre « La moisson amère : les soixante ans des Frères musulmans » Zawahiri explique que les Frères Musulmans sont devenus des instruments du projet occidental, notamment à cause de leur participation à des élections démocratiques qu’il juge contraires à la souveraineté divine.
Il rejoint alors les rangs d’Al-Qaïda, puis en deviendra le chef après la mort d’Oussama ben Laden, consolidant la fusion entre idéologies qutbienne et stratégie jihadiste transnationale.
Une stratégie d’influence par le tissu associatif
Bien que les Frères Musulmans n’emploient pas la force, de nombreux pays tels que l’Égypte, l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes et la Russie ont interdit l’organisation. En Europe, les Frères Musulmans utilisent des organisations caritatives et éducatives pour construire un réseau d’influence.
Présence en France
En France, ce rôle est notamment incarné par l’Union des Organisations Islamiques de France (UIOF), fondée en 1983 et renommée Union des organisations islamiques de France en 1989. Elle regroupe environ 280 associations musulmanes à travers le pays qui, pour la plupart, gèrent des mosquées.
On y retrouve par exemple l’Association des musulmans d’Alsace, dont une salariée avait apporté un couteau lors d’une visite conjugale en prison, suite à laquelle son mari avait poignardé deux surveillants pénitentiaires dans un acte qualifié de terroriste par la ministre de la Justice de l’époque.
Une enquête, menée par un journaliste du Figaro, a révélé que certaines associations musulmanes d’Alsace bénéficiaient de financement du Qatar afin de favoriser un islam global. Totalement légale, cette démarche a pour but de développer l’islam politique en Europe.
Dans un congrès organisé par l’UIOF à Lille en 2016, la journaliste Laurence Marchand-taillade révélée que plusieurs figures controversées avaient été invitées à participer. Mohamad Rateb Al-Nabulsi, un prédicateur syrien ayant déclaré dans l’un de ses écrits qu’il fallait tuer les apostats, Abdellah Sana’an imam à Médine signataire d’un appel au djihad en Syrie et Tariq Ramadan prédicateur suisse d’origine égyptienne accusé par Caroline Fourest dans son livre Frère Tariq : Discours, stratégie et méthode de Tariq Ramadan de double discours en fonction de son auditoire étaient par exemple invités.
Le livre-enquête Inchallah, l’islamisation à visage découvert publié par Gérard Davet et Fabrice Lhomme, tout deux journalistes pour Le Monde met en lumière l’instauration de lois religieuses tacites en Seine Saint-Denis.
Le cas suisse
En Suisse, nous disposons de l’un des plus anciens centres islamiques du pays à Genève. Fondé en 1961 par Saïd Ramadan, le centre a pour but de « lutter contre le matérialisme athée » et « servir Dieu ». Son créateur rejoint les Frères Musulmans à 14 ans avant de devenir le secrétaire personnel d’Hassan El Banna, fondateur de la société secrète. Il se rendra en Palestine afin de créer une branche de l’organisation sur place avant d’aller au Pakistan, où il représentera la confrérie à la Conférence islamique mondiale de Karachi. Ce parcours illustre l’empreinte idéologique forte que Saïd Ramadan a léguée au Centre islamique de Genève.
Loin d’être un simple lieu de culte, ce centre a rapidement acquis une portée politique et symbolique bien au-delà des frontières suisses. Il est devenu, dans les décennies suivantes, un point de ralliement pour diverses figures influentes du monde musulman, souvent liées aux mouvements islamistes transnationaux.
Son influence s’étend également sur le plan intellectuel. Des ouvrages de penseurs islamistes majeurs y ont été traduits, diffusés et débattus, contribuant à forger un espace de réflexion aligné sur une vision politique de l’islam. Parallèlement, le centre a été perçu par certains services de renseignement occidentaux comme un point névralgique du réseau des Frères musulmans en Europe.
Cette image a été renforcée par les prises de position controversées de son actuel directeur, Hani Ramadan, fils du fondateur. Ce dernier s’est fait connaître pour ses déclarations polémiques, notamment dans une tribune publiée en 2002 dans Le Monde, dans laquelle il défendait l’application de la lapidation en tant que sanction islamique, qu’il qualifiait de « dissuasive et purificatrice ». Il y évoquait également le sida comme une sanction divine, des propos largement condamnés par les milieux scientifiques et les défenseurs des droits humains. Ses positions très conservatrices sur les rôles et la tenue des femmes, la séparation des sexes, et la sexualité hors mariage ont également été critiquées comme étant en contradiction avec les principes fondamentaux de la société suisse.
Ces propos ont conduit à son licenciement du service public genevois, où il exerçait en tant qu’enseignant, et ont durablement terni l’image du centre aux yeux de l’opinion publique. Malgré cela, Hani Ramadan continue de se présenter comme le défenseur d’un islam « authentique » face à une société occidentale qu’il juge en déclin moral, rejetant les accusations d’extrémisme comme des tentatives de disqualification politique.
Défis contemporains
Dans ce contexte, la Suisse, connue pour sa neutralité et sa tradition d’accueil, s’est retrouvée à jouer un rôle involontaire de plateforme pour des dynamiques géopolitiques complexes. Aujourd’hui encore, cet héritage continue d’influencer les débats sur l’islam politique, l’intégration et la sécurité nationale.
Source: https://lesobservateurs.ch
Textes de Futur CH en relation avec ce sujet :
Le principe de l’abrogation dans l’islam : fondement de la violence
M. Hikmat
Une réforme de l’islam : possible ou impossible ?
Shafique Keshavjee
Les préceptes de l’islam sont-ils compatibles avec nos lois ?
Amine Abdelmajide
Petit lexique de l’islam
Les 50 principaux concepts de l’islam
Heinz Gstrein
Plus d’islam, moins d’Europe ?
Violence et migration
Qu’est-ce que la charia ?
Le califat : un idéal islamique
Faut-il interdire le port du voile aux mineures
L’image de la femme dans l’islam
Taqiya
Les appels au combat en islam
Burqa (nouvelle édition)
L’appel du muezzin en Europe
Islam et homosexualité
Quelle place de Jésus dans le Coran et la Bible
L’islam autorise-t-il la poignée de main ?